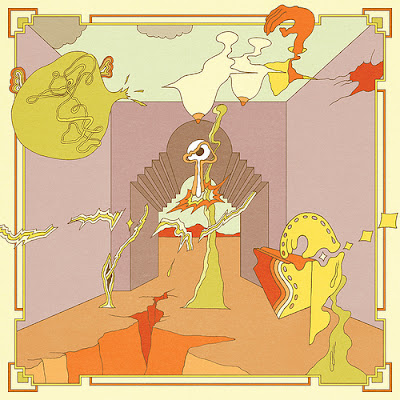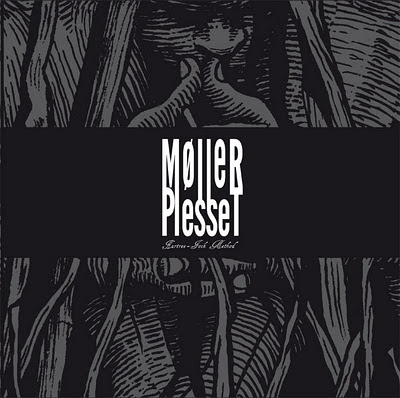Lorsque j’ai enfin failli parler aux membres d’
Oxbow cela a été de manière totalement fortuite et de toute façon cela n’aurait pas été pour leur dire grand-chose. Le groupe tournait pour
An Evil Heat qui venait tout juste de paraitre chez Neurot recordings. La date lyonnaise avait lieu au Gourbi, un squat détruit depuis bien longtemps pour laisser la place à un magnifique immeuble d’affaires. J’attendais après la première partie – il s’agissait de Ned qui remplaçait au pied levé The Blues Butcher Club (première version) parce que le guitariste de ces derniers avait eu la bonne idée de se casser un bras – et j’étais vraiment très impatient de revoir Oxbow sur une scène pour déjà la troisième fois. J’ai vu de l’autre côté de la rue cette bande de gamins en train de faire les cons avec mon vélo : je les ai poursuivis, rattrapés, l’un d’eux criait à un autre « c’est le mec du vélo, il va te casser la tête » mais je l’ai choppé facilement, ai expliqué que j’en avais rien à foutre du reste, ils se sont barrés sans comprendre et je suis retourné en direction du Gourbi plutôt content de m’en être sorti de cette façon là. Tout Oxbow était dehors en train de prendre le soleil, ils m’avaient bien regardé, assis devant leur tourvan noir, comme à un spectacle. Lorsque je suis passé devant eux ils étaient tout sourires, Eugene Robinson a commencé à me demander quelque chose, je n’ai rien compris, j’étais encore énervé, il a répété, j’avais l’air d’un con avec mon vélo alors je suis allé le plus vite possible le planquer dans un coin du squat pour que tout cela ne recommence pas. Ce jour là Oxbow a donné l’un des deux meilleurs concerts que j’ai jamais vus du groupe. J’étais littéralement heureux.
La seconde fois c’était au Sonic, pour la tournée suivant la parution de The Narcotic Story, à l’été 2007. J’étais arrivé terriblement en avance, tellement en avance que Niko Wenner se détendait sur le pont de la péniche en gratouillant sa guitare acoustique. Il répondait aux bonjours de tous ceux qui passaient devant lui. A l’intérieur il n’y avait encore personne, les portes n’étaient même pas censées être déjà ouvertes et Eugene Robinson installait consciencieusement le marchandising du groupe. Je me suis alors précipité vers lui, ai tout de suite acheté un exemplaire de The Narcotic Story en baragouinant avec une grosse boule coincée au travers de la gorge que je l’écoutais en streaming sur le site d’Hydra Head depuis déjà plusieurs semaines et que je l’aimais beaucoup. En guise de réponse j’ai eu droit à un immense sourire blindé de dents blanches et carnassières et Eugene Robinson, oui le chanteur d’Oxbow, a commencé à vouloir bavarder avec moi – comme d’habitude je n’ai rien compris et j’ai tout fait pour fuir, rapidement, le plus loin possible de lui. Ce jour là Oxbow a donné l’un des deux moins bons concerts que j’ai jamais vus du groupe. J’étais un peu déçu mais toujours heureux.

Et donc, lorsque le DVD d'
Oxbow – The Luxury Of Empire est arrivé dans les locaux de la rédaction de 666rpm, je n’ai pas attendu pour le visionner. Je l’ai fait tout de suite, terriblement impatient, presque affamé.
Pourtant je n’ai pas vraiment changé d’avis à propos de la plupart des DVD musicaux. Les reportages complaisants racontant aux fans d’un groupe comment est né celui-ci, comment il a gravi un par un les échelons du succès – ce qui est très éloigné de la réalité d’Oxbow –, comment il est forcément devenu le groupe le plus important de tous les temps et comment ces mêmes fans sont très exactement en train de se faire arnaquer pour découvrir une histoire qu’ils connaissent pourtant par cœur, (oui mais cette fois-ci la « découverte » se fera en 5.1) ? Je déteste ça. Encore plus que les DVD qui retracent des concerts – les rares exceptions concernent les groupes en activité alors que j’étais à peine né ou en âge d’être passionné par autre chose que la musique.
Oxbow – The Luxury Of Empire est la parfaite antithèse de ce genre de bouillasse marketing et est très nettement supérieur au commun des DVD avec son très beau reportage signé
Mariexxme, un tour diary plus anecdotique par le propre sonorisateur d’Oxbow en bonus ainsi que l’intégralité du concert donné par Oxbow en novembre 2009 à La Maroquinerie de Paris, à nouveau filmé par Mariexxme.
Plus que tout,
Oxbow – The Luxury Of Empire (on désignera désormais ainsi le seul reportage principal du DVD) remplace toute forme de complicité baveuse, arrangée et marketée par quelque chose de bien plus noble et de bien plus distingué et qui se passe de commentaires acerbes : on est complètement dans le registre justifié et assumé de l’admiration profonde et de la fascination. Sans aucun doute parce que, voilà, Oxbow est réellement un groupe à part et que ce DVD n’est pas là pour prouver quoi que ce soit mais bien pour nous faire partager quelque chose de différent.
Il y a tant de choses que je ne sais donc pas, que je n’ai jamais osé demander au groupe après un concert, alors que d’autres y allaient et que les musiciens – pourtant épuisés – acquiesçaient à toutes les sollicitations, Eugène Robinson en tête. The Luxury Of Empire y répond très partiellement et la réussite de ce documentaire provient essentiellement de sa sobriété : interviews plongées dans la pénombre, on n’entend jamais les questions de l’intervieweur, seulement les réponses des membres d’Oxbow, pas d’effets numériques à la con ni de son méga surgonflé, montage simple et jamais racoleur. Une sobriété et un calme qui claquent violemment avec les extraits de concerts et le groupe en action, sur scène, en pleine ascension émotionnelle.
Le reportage de Mariexxme possède ainsi l’immense qualité de pallier à la frustration que les peine-à-jouir dans mon genre peuvent éprouver par manque de proximité avec un groupe que pourtant ils admirent. Oxbow fascine, attire et, en même temps, Oxbow fait toujours peur. Mais, et c’est très important, The Luxury Of Empire distille aussi suffisamment d’ombres, de mystères, de propos obscurs – on n'y comprend strictement rien à cette leçon de symbolisme appuyée par l’exemple des nombreux tatouages d’Eugene Robinson –, de pudeur et de retenue de la part des musiciens du groupe pour que le moteur à fascination (encore elle), mu par ce simple tour de manivelle, reparte pour une nouvelle période indéterminée.
Le documentaire est en outre (très bien) sous-titré en français et les interviews confirment aisément deux autres choses : premièrement les gens d’Oxbow sont selon les moments disponibles, avenants, malades, fatigués, tendus, sympathiques, déplaisants, en colère ou insatiables mais ils ne sont jamais indifférents ; deuxièmement ils ont une idée très supérieure de leur musique – ce n’est pas de la prétention mal placée, ils expliquent seulement (surtout Niko Wenner) que ce à quoi ils veulent aboutir, ce qu’ils ont toujours voulu faire, est quelque chose de très difficile, de très exigent et de très ambitieux, qu’ils y arrivent peut être à peine aujourd’hui (les interview datent de 2009).
Still Before, le journal de tournée que Manuel Liebskind a filmé à l’aide de son téléphone portable, a le mérite d’apporter quelques détails du quotidien, toujours avec beaucoup d’humour, souvent de façon impromptue – comme ce passage où on découvre Marie qui explique aux quatre Oxbow qu’elle veut faire un documentaire sur eux, comment elle voit les choses, ce qu’elle propose au groupe, les regrets à propos de l’épisode du concert lyonnais avec sa sono terriblement déficiente et ses sleepings jugés inappropriés (cet épisode se finira à l’hôtel) ou les retrouvailles sur une aire d’autoroute entre Oxbow et Lydia Lunch alors en tournée avec Big Sexy Noise. Quant au concert d’Oxbow à la Maroquinerie, il ne fait que confirmer une seule chose, déjà mentionnée un peu plus haut : Oxbow est bien un groupe terriblement à part et définitivement différent.
Le DVD
Oxbow – The Luxury Of Empire est disponible sur le site de
Mariexxme.