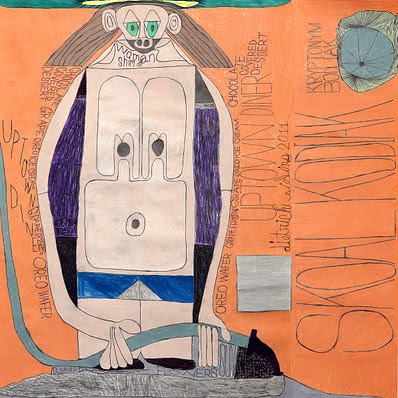Une fois n’est pas coutume, direction le
Clacson à Oullins pour un concert dont
l’affiche est pour le moins hétéroclite : Sheik Anorak, Electric Electric
et surtout Doomsday Student. Une soirée coproduite – donc – par le Clacson,
Grrrnd Zero hors les murs et l’Association
Versaillaise des Nouveaux Maitres du Monde.
Après un périple cafardeux dans les bouchons
lyonnais, je ne parle pas des restaurants à touristes mais des bouchons composés
d’automobilistes qui préfèrent oublier que demain ils n’auront plus les moyens
de mettre du carburant dans leur moteur, je me gare enfin – non sans avoir à faire
quelques périlleuses manœuvres – pile devant la salle et en bon privilégié
que je suis ce soir ; car je suis en plus chauffeur pour Sheik Anorak, ce qui aura
pour moi le double avantage de ne pas payer ma place de concert (contre l’avis
virulent et mercantile du plus jeune organisateur de la soirée) et de me bâfrer
sans retenue au catering, goûtant une splendide tarte à l’aubergine pas loin de
rivaliser avec les anciens exploits culinaires de Maquillage & Crustacés – lequel
promet toujours de revenir sous peu à l’organisation de concerts.
Et puis assister
même de loin aux balances des groupes est toujours un plaisir particulier.
Pendant que les musiciens, les techniciens, les
organisateurs du concert, l’équipe pléthorique de bénévoles de la salle et les
pique-assiettes dans mon genre se gavent au frais de la princesse, le Clacson
se remplit doucement mais sûrement ; mais il n’y aura pas autant de monde
qu’espéré au départ et on peut se demander où sont passés les lyonnais,
d’autant plus que dans l’assistance on comptait nombre de stéphanois, des
marseillais, des nîmois en transit et, pire encore, des parisiens en vacances.
SHEIK ANORAK
joue malgré tout devant une audience confortable et surtout très
attentive : beaucoup de personnes venues ici ce soir découvrent pour la première fois ce one man
band particulièrement apprécié dans les colonnes de 666rpm et elles repartiront convaincues
et avec le sourire du nouveau fan aux lèvres.
Le dispositif de Sheik Anorak – boucles de guitare superposées et batterie – ne
change évidemment pas mais ce
garçon cherche toujours de nouveaux moyens pour affiner et affirmer sa noise
mélodique et racée ; aux côtés de ses compositions habituelles (un premier titre qu’il joue depuis ses tout débuts, un autre chanté, tubesque en diable et qui avait surpris tout le monde il y a quelques mois et, enfin, une composition plus atmosphérique en clôture de set), Sheik Anorak a présenté une vraie nouveauté..
Et quelle nouveauté. Jouée simultanément à la
guitare et à la batterie – donc sans faire appel à la superposition de
multiples boucles – cette nouvelle composition comporte elle aussi du chant et
surtout allie deux parties distinctes ; une première très immédiate, avec voix et bien tournée ; une seconde instrumentale, plus rêche, plus
abrupte et privilégiant la répétition et l’atonalité. Un effet deux en un qui
laisse pantois parce qu’on ne peut pas choisir, l’articulation entre les deux
parties se fait naturellement et le glissement de la mélodie vers le bruit et
l’expérimental semble aller de lui-même. Un beau moment.
Contre toute attente les
DOOMSDAY STUDENT jouent en deuxième. Ce
sont les américains qui l’ont demandé et c’est plutôt une bonne idée. J’en
connais quelques-uns qui se sont tapé quelques centaines de kilomètres pour
assister au concert de ces ex Arab On Radar – uniquement trois dates française
sur toute la
tournée européenne : Paris, Lyon et Toulouse – et ils ne vont
pas être déçus du voyage.
Précisons que la référence à l’ancien groupe formé
par trois des quatre membres de Doomsday Student n’est absolument pas
fortuite : tout comme l’album
A Jumper’s Handbook réitérait les
exploits d’antan, un set de Doomsday Student comporte la même dose de folie
hystérique que ceux d’Arab On Radar il y a plus de dix ou quinze ans – à
l’exception du Guitariste Paul Vieira (Chinese Stars) qui ne fait qu’assurer correctement
avec ses belles guitares à manche en alu et ses tatouages. Les trois autres, le
chanteur détraqué Eric Paul, le batteur maniaque Craig Kureck et surtout le
guitariste loup-garou Stephen Mattos, passent pour de vrais psychopathes.
Lorsqu’on joue une musique aussi barrée et sale,
le vrai talent consiste avant toutes choses à faire oublier au public que l’on
est peut-être en train de jouer un rôle et à se lâcher complètement, loin de
tout professionnalisme apparent. Les quatre Doomsday Student y arrivent très
bien, misant sur des effets simples (les lumières aveuglantes qui poussent
Kureck à porter ses lunettes noires sont toujours là) mais avec une véritable
attitude scénique. En plus les quatre musiciens sont tous habillés à l’identique,
chemises et pantalons noirs avec des baskets oranges, et cela suffit à donner
l’impression qu’ils font corps tous ensemble.
La musique du groupe – chant de sirène asexuée,
guitares tordues et dissonantes jusqu’à la douleur et batterie quasiment mono
rythmique – n’aurait pas pu supporter autre chose que ce déversement hystérique
et malade, parfois à la limite de l’obscène. Le public a apprécié même s’il a
été loin d’atteindre le niveau d’explosion mérité. Une grosse demi-heure et un
rappel plus tard (!), les quatre Doomsday Student étaient claqués, à genoux et
c’était fini, sans la possibilité, on le savait pourtant, de revivre ça une
seconde fois, tout de suite et maintenant. Il ne fallait surtout pas rater ça.
Les trois
Electric Electric jouent donc en dernier. Le groupe est installé en ligne avec le
batteur au milieu et devant ; les musiciens sont comme bloqués derrière
une impressionnante quantité de matériel – percussions additionnelles,
synthétiseurs, etc… – qui fait barrière entre eux et le public.
J’ai malheureusement toujours un problème avec
Electric Electric en concert : autant j’apprécie beaucoup la musique du
groupe sur disques – comme le deuxième et récent album
Discipline mais je ne peux également
que conseiller son prédécesseur
Sad
Cities Handclappers – autant celle-ci passe de moins en moins la barre sur
scène. Un phénomène qui me laisse perplexe, mais il en est ainsi.
Fort heureusement pour les garçons d’Electric
Electric, fort sympathiques au demeurant, tout le monde n’est pas de mon avis de ronchon acariâtre, le groupe
trouve sans problème son public et captive nombre de personnes s’agitant frénétiquement
devant la scène. Je concède malgré tout que l’écoute du désormais vieux hit The Left Side m’a à nouveau fait
chavirer. Mais c’est bien tout.
Bon, après tout ça il n’y avait plus qu’à repartir en
voiture et dans la direction opposée avec tout le
matériel
de Sheik Anorak, une nouvelle occasion
pour
moi de prouver à la Terre entière que j’étais bien un conducteur de tout
premier ordre.
[quelques photos du concert
ici]